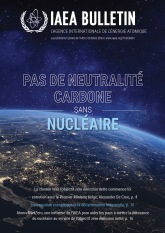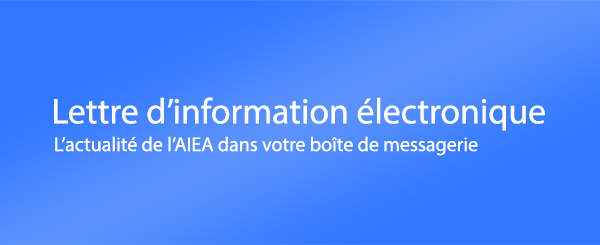
Si vous souhaitez en savoir plus sur les activités de l’AIEA, abonnez-vous à notre lettre électronique mensuelle pour recevoir les principales informations, multimédias et autres.
Cap sur l’essor de la filière nucléaire
La polyvalence de l’approche par étapes de l’AIEA
Wolfgang Picot

Le cheminement vers l’électronucléaire étant une entreprise complexe, l’approche par étapes de l’AIEA s’est imposée en donnant un cadre essentiel aux pays qui s’engagent sur cette voie ardue. Pour nombre d’entre eux – qu’il s’agisse de pays primo-accédants comme le Ghana ou l’Estonie ou d’acteurs établis en quête d’expansion ou de planification stratégique –, le caractère structuré de l’approche par étapes a démontré sa polyvalence et son caractère indispensable.
L’approche par étapes de l’AIEA repose sur une méthode progressive et complète conçue pour aider les pays à élaborer leurs programmes électronucléaires. Cette méthode joue un rôle décisif, car elle fournit une feuille de route aux pays, des premiers stades de l’étude de l’option électronucléaire à la phase d’exploitation, un processus qui s’étend sur environ 10 à 15 ans.
Seth Kofi Debrah, de la Commission ghanéenne de l’énergie atomique, explique l’importance de l’approche par étapes : « L’approche par étapes fournit une feuille de route de très haut niveau et des orientations sur la manière de se préparer. L’élaboration d’un projet d’infrastructure d’une telle ampleur représente un défi pour les pays primo-accédants et l’approche par étapes propose une structure formelle complète pour y parvenir. »
Le Ghana, l’un des pays disposés à adopter l’électronucléaire, a créé l’Organisation du programme électronucléaire du Ghana qui est chargée de coordonner des activités préparatoires. La feuille de route du pays, qui s’étale sur 15 ans, s’articule autour des trois phases de l’approche par étapes de l’AIEA et prévoit de fournir 700 à 1 000 mégawatts électriques (MWe) supplémentaires au réseau national d’ici 2030.
L’Estonie, quant à elle, considère également que l’électronucléaire est un choix énergétique à la fois fiable et bas carbone. Reelika Runnel, coordinatrice du groupe de travail sur l’énergie nucléaire de l’Estonie, souligne que l’approche par étapes leur a servi de point de départ : « Elle donne un aperçu de l’ampleur des travaux nécessaires à la mise en place d’un programme nucléaire et couvre tous les sujets liés à l’énergie d’origine nucléaire. Elle permet de rassurer les décideurs politiques, car ils peuvent prendre des décisions sur la base de l’expérience acquise par l’AIEA, qui s’appuie elle-même sur celle de nombreux États Membres. »
À mesure que le paysage énergétique évolue, les projets électronucléaires à grande échelle traditionnels cèdent en partie la place aux petits réacteurs modulaires (PRM). Consciente de cette évolution et compte tenu des limites que comporte l’intégration de grands réacteurs dans son réseau électrique relativement petit, l’Estonie étudie la possibilité de recourir aux PRM. « L’approche par étapes est aussi pleinement applicable aux PRM. Même si le modèle des PRM diffère de celui des réacteurs classiques, les mêmes ensembles de règlements sont applicables », explique Mme Runnel.
“ L’élaboration d’un projet d’infrastructure d’une telle ampleur représente un défi pour les pays primo-accédants et l’approche par étapes propose une structure formelle complète pour y parvenir.
Seth Kofi Debrah partage cet avis et souligne que l’approche par étapes reste un outil essentiel, quelle que soit la taille du réacteur : « Qu’il s’agisse d’un grand ou d’un petit réacteur, vous aurez besoin de l’approche par étapes pour vous guider. Le gouvernement doit prendre des décisions et établir les lois et les règlements nécessaires, et il faut un exploitant pour financer et faire fonctionner le réacteur, tout comme pour les réacteurs de plus grande taille. Tout est là et l’approche par étapes reste un outil utile aux pays primo-accédants. »
Les PRM sont des installations nucléaires et, à cet égard, les 19 questions liées à l’infrastructure de l’approche par étapes s’appliquent généralement. Cependant, une prochaine version révisée de la publication intitulée « Étapes du développement d’une infrastructure nationale pour l’électronucléaire » – publication d’orientation relative à l’approche par étapes – traitera des aspects de l’infrastructure qui peuvent faire l’objet d’une mise en œuvre ou de considérations différentes dans le contexte du déploiement des PRM, selon les cas. Cette publication comporte une annexe qui expose les considérations en matière d’infrastructure qui se rapportent spécifiquement aux PRM.
Les PRM se distinguent également de leurs grands « frères » par le fait que les réacteurs sont traditionnellement construits et exploités dans le même pays. La méthode de construction modulaire utilisée pour les PRM signifie quant à elle qu’ils peuvent être construits dans un pays puis expédiés, assemblés et exploités dans un autre. De ce fait, il faudra peut-être intégrer les prescriptions applicables dans un système plus internationalisé dans le cadre d’un accord et d’une reconnaissance mutuelle de la réglementation entre les parties prenantes. À cet égard, l’approche par étapes fonctionne en synergie avec l’Initiative d’harmonisation et de normalisation nucléaires (NHSI) de l’AIEA.
Initialement conçue à l’intention des pays qui se lancent dans des programmes nucléaires, l’approche par étapes s’avère tout aussi pertinente pour les acteurs établis qui cherchent à optimiser ou à planifier stratégiquement leurs capacités nucléaires. Aline des Cloizeaux, directrice de la Division de l’énergie d’origine nucléaire à l’AIEA, rappelle son rôle dans l’évaluation des infrastructures nucléaires : « On constate qu’en Europe, plusieurs pays envisagent actuellement de relancer des projets ou d’étendre des projets existants. La méthodologie de l’approche par étapes peut contribuer à l’évaluation de leur infrastructure nucléaire actuelle. »
Même pour les pays ayant une expérience de l’exploitation nucléaire, il convient de réévaluer la maturité des infrastructures existantes à la fin de la phase 2 pour voir si elles présentent des lacunes par rapport au niveau recommandé par l’AIEA avant d’entamer la construction de nouveaux réacteurs. Lorsque des lacunes apparaissent, l’AIEA peut aider les pays qui développent leur programme électronucléaire dans des domaines tels que les chaînes d’approvisionnement, les réseaux énergétiques, les ressources humaines et d’autres aspects de l’infrastructure au sens large.
L’adaptabilité et la polyvalence de l’approche par étapes sont d’autant plus pertinentes au regard des prévisions annuelles de l’AIEA sur l’électronucléaire, lesquelles prévoient une augmentation significative de la capacité nucléaire installée pour atteindre 890 gigawatts (GW) d’ici 2050, ce qui souligne la contribution potentielle de la filière à l’objectif de neutralité carbone. La tendance devrait s’accentuer : les dirigeants de 22 pays de quatre continents se sont réunis le 2 décembre 2023 pour annoncer la signature d’une déclaration visant à faire progresser l’objectif mondial de tripler la capacité mondiale d’énergie d’origine nucléaire d’ici 2050. Une trentaine de pays participeront au tout premier Sommet de l’énergie nucléaire, qui se tiendra à Bruxelles en mars 2024 et sera coprésidé par le Directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, et le Premier Ministre belge, Alexander De Croo, ce qui souligne le nouvel élan donné à l’électronucléaire.
Grâce à son adaptabilité et sa polyvalence, l’approche par étapes continuera à jouer un rôle important dans tout ce qui touche à l’avenir de l’énergie nucléaire et à sa contribution essentielle à la résolution des enjeux mondiaux, tels que la réduction de la consommation de combustibles fossiles et le renforcement de la sécurité énergétique.