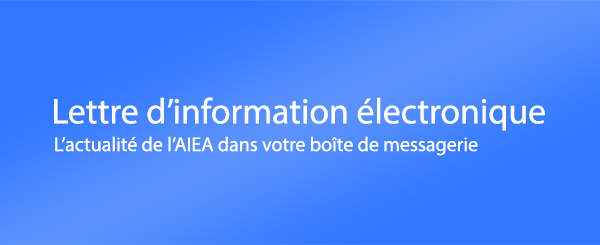Nonobstant ses avantages socio-économiques et sa contribution à l’atténuation des changements climatiques, l’électronucléaire traîne, depuis l’incident de Fukushima, une réputation bien difficile à défendre. Pour quelle raison ? Et que faire pour y remédier ?
L’énergie nucléaire est la principale source d’électricité à faible émission de carbone dans les pays avancés. Au cours des 50 dernières années, le recours à l’électronucléaire a permis d’éviter l’émission de plus de 60 gigatonnes de CO2, soit l’équivalent de près de deux années d’émissions produites par le secteur énergétique au niveau mondial. Outre le rôle qu’elle joue dans l’atténuation des changements climatiques, l’énergie nucléaire contribue à la pureté de l’air, car, grâce à elle, ce sont autant de particules et autres polluants que nous n’émettons pas. Autre point fort : sa production allie fiabilité, prévisibilité et rentabilité. L’énergie nucléaire génère par ailleurs de nombreux emplois locaux durables et de qualité, et induit d’importants avantages socio-économiques, un facteur non négligeable dans le contexte de la reprise post-COVID2. Pourtant, rien n’y fait : la perception du public continue de pénaliser ce secteur, les préoccupations concernant la sûreté et les déchets nucléaires venant masquer toutes les autres réalisations que l’on peut porter à son crédit.
Contrairement à ce qui s’était passé lors de l’accident de Tchornobyl, les acteurs de la filière nucléaire ont fourni quantité de données et informations lors de l’accident de Fukushima Daiichi. Mais, malgré cette transparence accrue, ils n’ont pas réussi, avec l’avènement de l’actualité continue et le foisonnement des informations diffusées sept jours sur sept, 24 heures sur 24, qui donnent à chacun la possibilité de faire valoir ses opinions sur Internet, à s’attirer la confiance du grand public.