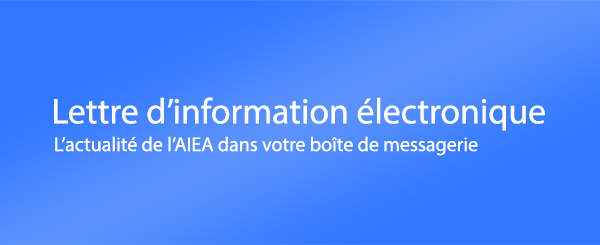Le Centre des incidents et des urgences de l’AIEA joue un rôle essentiel dans la préparation et la conduite des interventions en situation d’urgence nucléaire ou radiologique dans le monde.
De la préparation à la résilience : le rôle de l’AIEA dans la conduite des interventions en situation d’urgence nucléaire ou radiologique
Le Centre des incidents et des urgences de l’AIEA joue un rôle essentiel dans la préparation et la conduite des interventions en situation d’urgence nucléaire ou radiologique dans le monde. (Photo : D. Calma/AIEA)
Les situations d’urgence nucléaire ou radiologique sont peut-être rares, mais les conséquences qu’elles peuvent avoir exigent une vigilance et une préparation constantes. Le Centre des incidents et des urgences (IEC) de l’AIEA joue un rôle crucial dans la préparation et la conduite des interventions à l’échelle mondiale, en veillant à ce que les pays soient prêts à gérer ces situations complexes.
Le Centre compte 29 experts permanents et plus de 200 agents qui se tiennent prêts à intervenir en cas de situation d’urgence nucléaire ou radiologique majeure de n’importe quelle nature. Il reste opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et peut intervenir à pleine capacité s’il reçoit un signalement qui répond aux critères établis – par exemple, en cas de situation d’urgence dans une centrale nucléaire.
Le Centre est prêt à réagir à tout scénario susceptible d’avoir une incidence sur la sûreté et la sécurité nucléaires et à informer les États Membres et le public. Par exemple, le 1er janvier 2024 à 7 h 10 UTC, un séisme de magnitude 7,6 a frappé la préfecture d’Ishikawa (Japon). À peine plus d’une heure plus tard, le responsable de l’intervention d’urgence de l’AIEA a reçu un message via le Système unifié d’échange d’informations en cas d’incident ou d’urgence (USIE) de l’AIEA : six des centrales nucléaires japonaises avaient potentiellement été touchées. Heureusement, aucune anomalie n’a été signalée, et les autorités japonaises ont inspecté minutieusement les centrales pour s’assurer qu’aucune d’entre elles n’avait été compromise ou endommagée. À midi ce jour-là, le Japon a envoyé une mise à jour pour confirmer que toutes les centrales nucléaires du pays fonctionnaient normalement. L’information a été postée sur l’USIE et les pays l’ont reçue en quelques secondes. L’AIEA a également publié une mise à jour sur les réseaux sociaux, pour rassurer le public, expliquant qu’elle était en contact avec les autorités japonaises, qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter et que les opérations de surveillance se poursuivaient.
La notification rapide, la diffusion proactive d’informations et la communication continue avec les autorités nationales – même si la sûreté des populations n’est pas menacée, comme dans l’exemple ci-dessus – sont les meilleures pratiques d’atténuation des risques de catastrophe. Elles ont été définies à partir des leçons tirées des interventions d’urgence passées, comme l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi.
Autre exemple : en mai 2024 au Libéria, une source radioactive a été découverte dans un canal d’eaux pluviales au Centre médical John F. Kennedy, le plus grand hôpital du pays. L’intervention rapide de l’AIEA a permis d’éviter un incident radiologique et l’hôpital a pu poursuivre ses activités sans interruption.
Les catastrophes peuvent également se cumuler : par exemple, un séisme peut entraver la gestion d’une situation d’urgence nucléaire. Il est essentiel d’identifier les différents scénarios de risques, de les catégoriser et de se préparer à réagir rapidement. À l’instar des pandémies et des catastrophes naturelles, les situations d’urgence nucléaire ou radiologique ne connaissent pas de frontières, ce qui rend d’autant plus nécessaires la coordination internationale et la mise en commun des informations.

Une rangée de camions de pompiers prêts pour une intervention dans le cadre de l’exercice national de préparation « Valahia » en Roumanie, en octobre 2023. (Photo : C. Torres Vidal/AIEA)
Le rôle de l’AIEA dans la préparation mondiale aux situations d’urgence
L’IEC de l’AIEA joue un rôle essentiel en aidant les pays à s’acquitter de leurs obligations découlant des conventions internationales sur les accidents nucléaires – des textes rédigés au lendemain de l’accident de la centrale nucléaire de Tchornobyl en 1986, lorsque le monde a pris conscience qu’il était nécessaire de disposer d’un cadre international solide pour la coopération en cas d’urgence nucléaire.
La Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire vise à garantir que les pays transmettent rapidement les informations pertinentes sur les accidents nucléaires ou les urgences radiologiques, afin de limiter autant que possible les éventuelles conséquences radiologiques transfrontières. La Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique facilite quant à elle la coopération entre les pays et l’AIEA pour permettre de fournir une assistance rapide en cas d’urgence, et ainsi protéger des vies, des biens et l’environnement.
Créé en 2005, l’IEC est le point focal mondial pour la préparation, la déclaration des événements, la mise en commun des informations et la conduite coordonnée des interventions en cas de situation d’urgence nucléaire ou radiologique de n’importe quelle nature.
Les initiatives éducatives constituent également un élément clé de la mission plus large de l’AIEA visant à renforcer la préparation mondiale aux situations d’urgence nucléaire ou radiologique. L’AIEA a récemment organisé sa première session en français de l’École de gestion des situations d’urgence radiologique, au Maroc, qu’elle a axée sur l’atténuation des conséquences des incidents nucléaires et radiologiques. Dix-neuf professionnels du nucléaire venus de pays francophones d’Afrique y ont participé et ont été formés par des experts de l’AIEA et du Maroc sur l’évaluation des risques, la coordination pour les situations d’urgence, la communication avec le public et les techniques de terrain. Ce programme vise à développer les capacités en matière d’interventions d’urgence, afin que les participants puissent gérer efficacement les situations d’urgence radiologique et veiller à ce que les populations et l’environnement ne subissent aucun préjudice. Organisées conjointement avec l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), un centre collaborateur de l’AIEA, ces sessions de formation favorisent la coopération régionale et l’autonomie en matière de préparation aux situations d’urgence. Depuis sa création en 2015, l’École a organisé 15 sessions à travers le monde, et de nouveaux supports de formation sont maintenant disponibles en français pour les futures sessions en Afrique et en Europe.
Coordonner les interventions à l’échelle mondiale
Au cœur du travail de l’IEC se trouve la coordination internationale. Conformément aux conventions sur les situations d’urgence, l’IEC mobilise des experts internationaux et coordonne les efforts internes de l’AIEA en matière de préparation et d’intervention. Il travaille également en étroite collaboration avec d’autres organisations internationales, telles que l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’Organisation météorologique mondiale (OMM), afin de faciliter une intervention coordonnée lorsque cela est nécessaire.
L’IEC prête assistance aux pays 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en cas d’événement nucléaire ou radiologique, y compris en cas de menace pour la sécurité. Sa plateforme centrale, le Système unifié d’échange d’informations en cas d’incident ou d’urgence (USIE), permet aux pays de notifier l’AIEA et la communauté internationale en toute confidentialité et sûreté. Si la notification est obligatoire en cas d’urgence potentiellement transnationale, les pays sont également incités à signaler des événements de moindre envergure, et ce même s’ils ne présentent aucun risque immédiat pour la sûreté des populations – l’idée étant qu’ils pourraient susciter des inquiétudes chez ces dernières.
Par l’intermédiaire de l’USIE, les pays peuvent accéder à d’autres outils essentiels de l’AIEA, tels que le Système international d’information sur le contrôle radiologique (IRMIS), qui permet de visualiser les données de contrôle radiologique, ainsi qu’à des outils d’évaluation et de pronostic. Ces outils fournissent aux gestionnaires des situations d’urgence des informations cruciales sur l’évolution potentielle d’un accident nucléaire, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées et d’adopter rapidement des mesures de protection.
L’IRMIS aide les responsables de la gestion des urgences à déterminer les mesures de protection appropriées en cas d’urgence nucléaire en leur permettant de comparer les données radiologiques aux niveaux de sûreté préétablis (Niveaux opérationnel d’intervention, ou NOI). Par exemple, des niveaux de rayonnement élevés dans une zone spécifique peuvent exiger une évacuation ou un confinement. Ces informations sont accompagnées de codes couleur qui indiquent clairement la mesure à prendre, comme évacuer les zones touchées ou demander aux populations de rester à l’abri.
L’Outil d’évaluation des réacteurs permet à l’AIEA de fournir des informations sur les installations nucléaires, comme les réacteurs de puissance, en utilisant un langage simple et des diagrammes de couleur. Des homologues dans les États Membres transmettent leurs données de sûreté et l’AIEA peut alors apporter des mises à jour claires et rapides à tous les pays et au public sur la situation d’urgence.
L’IEC gère également le Réseau d’intervention et d’assistance (RANET), qui regroupe les États Parties à la Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique ayant indiqué les capacités nationales d’assistance – experts qualifiés, matériel et matériaux – qu’ils pourraient mettre à disposition pour aider un autre État dans ce cadre.
Dans le cadre du RANET, les pays proposent une assistance sous forme de levés radiologiques, de conseils ou de traitements médicaux, et d’équipements spécialisés pour aider à atténuer les conséquences d’une situation d’urgence nucléaire ou radiologique sur la santé, l’environnement et les installations. La France, représentée par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), aide également à définir les stratégies, prescriptions et moyens d’assistance internationale et à développer le Réseau. Elle a notamment pu apporter son aide au Pérou en 2012, lorsque trois travailleurs ont été surexposés à des rayonnements ionisants par accident, à Chilca. L’aide fournie comprenait des évaluations de dose et un traitement médical.
Collaboration avec d’autres organisations
En plus de ses outils internes, l’IEC collabore avec d’autres organisations qui fournissent des données essentielles lors de situations d’urgence. Par exemple, l’OMM effectue des prévisions de dispersion atmosphérique à partir des données météorologiques en temps réel, tandis que l’OMS se tient prête à mobiliser des moyens médicaux spécialisés dans les États Membres pour apporter de l’aide en cas de lésion causée par une utilisation inappropriée des sources de rayonnement. Grâce à cette coopération, les pays ont accès à des informations essentielles – qu’il s’agisse des conditions météorologiques ou de l’aide à apporter pour atténuer les conséquences d’une situation d’urgence nucléaire ou radiologique – et peuvent ainsi réagir efficacement aux situations d’urgence. L’IEC assure d’ailleurs également le secrétariat du Comité interorganisations des situations d’urgence nucléaire ou radiologique (IACRNE), qui coordonne toutes ces organisations dans la préparation et la conduite des interventions en cas d’incident ou de situation d’urgence nucléaire ou radiologique.
Assurer une préparation adéquate
La préparation est essentielle pour atténuer efficacement les conséquences d’une situation d’urgence nucléaire. L’IEC joue un rôle clé dans le renforcement des capacités nationales en fournissant des conseils et en dispensant des formations à divers professionnels dans le monde, notamment des spécialistes de la planification en cas d’urgence, des intervenants, des responsables de la réglementation et des responsables de l’information.
Le Centre effectue également des Examens de la préparation aux situations d’urgence (EPREV), qui aident les pays à évaluer et à renforcer leurs capacités nationales d’intervention en cas de situation d’urgence nucléaire ou radiologique, conformément aux normes internationales.
Les accidents nucléaires sont rares, en partie grâce au solide dispositif de sûreté et de préparation aux situations d’urgence déjà en place à l’échelle mondiale. Le Centre des incidents et des urgences de l’AIEA, par ses efforts de coordination, ses programmes de formation et ses partenariats internationaux, joue un rôle de premier plan dans le maintien de ce filet de sécurité. En encourageant la coopération internationale et en assurant une préparation à tous les niveaux, l’IEC contribue à atténuer les risques, de sorte que, même en cas de catastrophe, des mesures efficaces soient mises en place pour protéger les vies et l’environnement.