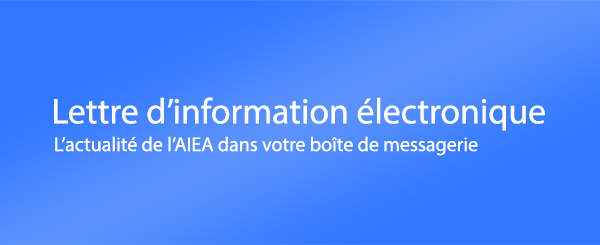Il faut le voir pour le croire ... lorsque les agriculteurs voisins se rendent au champ de manioc de Théogène Ntakarutimana, dans le centre du Burundi où le sol est de plus en plus aride, ils restent souvent bouche bée.
« Tous ceux qui visitent mon exploitation et voient comment je cultive le manioc sont enthousiasmés », raconte Théogène Ntakarutimana, qui a commencé en 2016 à appliquer des méthodes améliorées à l'aide de la science nucléaire et des techniques connexes. « Avant, mon rendement était faible, à peu près 11 tonnes à l’hectare, mais grâce à ces méthodes renforcées, il est passée à 30 tonnes, parfois même 33 tonnes à l’hectare. Les autres agriculteurs me posent des questions sur mes méthodes et tout le monde a envie d’apprendre ».
Le manioc, racine féculente, est la troisième source de glucides au monde après le riz et le maïs, et l’une des principales cultures commerciales pour de nombreux agriculteurs d'Afrique. Le continent africain en produit environ 55% à l'échelle mondiale, suivi par l’Asie avec environ 34%. Cependant, dans de nombreuses régions d’Asie et d’Afrique, des conditions rudes - sécheresse et manque d’eau, ou diminution de la fertilité des sols - nuisent aux exploitations traditionnelles et menacent la sécurité alimentaire.
En 2016, l’AIEA, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), s'est associée à des instituts de recherche et des associations d’agriculteurs pour accroître la production de manioc en mettant au point des pratiques améliorées de nutrition des sols et de gestion de l’eau faisant appel aux techniques dérivées du nucléaire. Ces nouvelles pratiques ont permis de tripler les rendements.