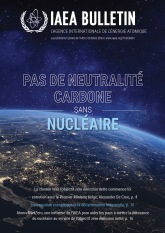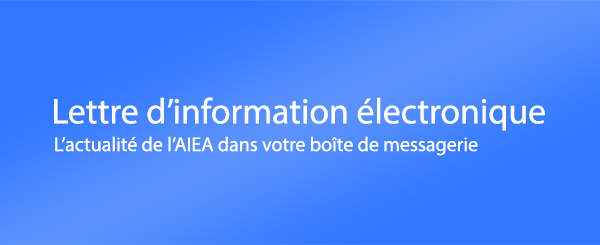
Si vous souhaitez en savoir plus sur les activités de l’AIEA, abonnez-vous à notre lettre électronique mensuelle pour recevoir les principales informations, multimédias et autres.
Les grands réacteurs, futur fer de lance de l’expansion électronucléaire malgré la progression des petits réacteurs modulaires
Joanne Liou
Porter la production d’énergie d’origine nucléaire au niveau nécessaire pour atteindre l’objectif zéro émission nette est un projet de taille qui comporte de multiples facettes. Et même si de nombreux modèles de réacteurs devraient jouer un rôle à cette fin, ce sont les grands réacteurs qui devraient ouvrir la voie. Les grands réacteurs refroidis par eau ont joué un rôle clé dans l’essor de l’industrie nucléaire au XXe siècle, et les réacteurs avancés prévus ou en construction aujourd’hui – d’une puissance généralement comprise entre 1 et 1,7 gigawatt électrique (GWe) – devraient fournir l’essentiel de la nouvelle capacité nucléaire.
« Pour les pays qui exploitent déjà des centrales nucléaires, ce sont les grands réacteurs à eau ordinaire, et non les petits réacteurs modulaires (PRM), qui seront le moteur de cette nouvelle capacité nucléaire », explique Aline des Cloizeaux, directrice de la Division de l’énergie d’origine nucléaire de l’AIEA. « La technologie des grands réacteurs a déjà fait ses preuves et peut fournir une charge de base importante et fiable, à moindre coût. Mais nous pensons que les pays et les industries exploiteront également le potentiel des PRM. »
En décembre dernier, dans une déclaration soutenue par des dizaines de pays présentée à la 28e session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28), le Directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, a lancé un appel retentissant en faveur de l’expansion de l’électronucléaire aux fins de la réalisation des objectifs mondiaux zéro émission nette. Cette position a été confirmée dans le bilan mondial, puisque pour la première fois en presque 30 ans d’existence, la Conférence y a inclus l’électronucléaire.
Dans son hypothèse haute, l’AIEA prévoit que la capacité de production d’énergie nucléaire fera plus que doubler d’ici 2050, passant de 371 GWe en 2022 à 890 GWe en 2050 – mais environ 10 % seulement de cette augmentation devrait provenir du déploiement de PRM. Pour atteindre cet objectif, il faut ajouter au moins 20 GWe par an. « Cette projection haute est ambitieuse mais techniquement réalisable », indique Henri Paillère, chef de la Section de la planification et des études économiques de l’AIEA.
Les réacteurs plus petits comme les PRM et les microréacteurs peuvent être particulièrement utiles pour fournir de l’énergie aux utilisateurs finaux industriels et aux communautés isolées disposant de réseaux électriques plus limités, et pour alimenter des applications non électriques telles que la production d’hydrogène et le dessalement de l’eau de mer. Toutefois, les PRM doivent encore faire leurs preuves avant d’être déployés à plus grande échelle. Les réacteurs de plus grande taille continueront à dominer le paysage de l’électronucléaire dans les années à venir.
La quasi-totalité des 58 réacteurs nucléaires actuellement en construction sont de grands réacteurs, et tant les pays qui exploitent déjà l’électronucléaire que les primo-accédants s’intéressent maintenant principalement aux réacteurs d’une capacité de 1 GW ou plus, bien que nombre d’entre eux envisagent également de déployer des PRM. La Pologne, pays primo-accédant qui entend se doter d’une capacité nucléaire d’ici le milieu des années 2030, compte sur les grands réacteurs de puissance pour créer une capacité de production comprise entre 6 et 9 GWe. La Chine, qui exploite actuellement 55 réacteurs, prévoit de multiplier par huit sa capacité nucléaire, pour passer à environ 400 GW d’ici 2060, principalement grâce au déploiement de grands réacteurs.
Les défis de l’expansion nucléaire
Selon M. Paillère, les plus grands défis de l’expansion de la capacité nucléaire sont ceux liés aux ressources financières et humaines : « Nous avons besoin de mécanismes pour encourager les investisseurs et le secteur privé à financer de nouveaux projets nucléaires. Il y a suffisamment d’argent pour financer la transition vers les énergies propres. Ce qui incite les investisseurs à la prudence face à l’électronucléaire, c’est le risque – par exemple les retards dans la construction. »
Après plusieurs décennies sans nouvelles constructions nucléaires, les grands projets nucléaires novateurs des pays occidentaux ont souvent été marqués par des dépassements de coûts et des retards, puisqu’il faut réacquérir les compétences et revitaliser les processus. « Certains de ces pays n’avaient construit aucune installation nucléaire depuis 20 ans. Il fallait former les ressources humaines et remettre sur pied les chaînes d’approvisionnement », explique M. Paillère. « L’augmentation de la capacité nucléaire suppose des constructions et de nouvelles connexions au réseau, ce qui signifie qu’il faut trouver davantage d’ingénieurs, de techniciens, de soudeurs, etc. La question des ressources humaines n’est pas propre au nucléaire, mais c’est un défi commun à toutes les technologies d’énergies propres. » Pour mener à bien les nouveaux projets de construction dans les délais impartis, il sera important de garder à l’esprit les enseignements tirés des projets passés, notamment en matière de gestion de projet et de participation des parties prenantes.
Dans certains pays, comme le Bélarus, la Chine, les Émirats arabes unis, la Fédération de Russie et la République de Corée, les projets de nouvelles constructions – dont la plupart portent sur des réacteurs avancés refroidis par eau – ont en grande partie été exécutés dans le respect des délais et du budget. « La conception standardisée des réacteurs avancés permet d’obtenir plus rapidement les autorisations et de réduire à la fois les coûts d’investissement et les délais de construction », explique Mme des Cloizeaux.
Essors passés et futurs
Les années 1970 ont été marquées par une montée en flèche de l’énergie d’origine nucléaire, principalement en Amérique du Nord et en Europe. En 1970, 15 pays exploitaient 90 réacteurs nucléaires de puissance, pour une capacité totale de 16,5 GWe. Chaque année au cours de la décennie ouverte en 1970, 25 à 30 projets de construction de tranches de réacteurs nucléaires ont été lancés. En 1980, 22 pays exploitaient 253 réacteurs nucléaires de puissance, pour une capacité totale de 135 GWe. Fin 1990, la capacité nucléaire mondiale avait plus que doublé, atteignant 326 GWe.
« L’industrie nucléaire et la chaîne d’approvisionnement étaient bien établies et capables d’ajouter 30 GW par an », indique M. Paillère. « C’est encourageant car, à l’époque, seuls quelques pays étaient à l’avant-garde de cette tendance, comme les États-Unis d’Amérique, la France et le Japon. Aujourd’hui, la Chine et la Fédération de Russie sont devenues des acteurs de premier plan et disposent de la chaîne d’approvisionnement et de l’industrie nécessaires pour soutenir l’expansion de l’électronucléaire. »
La relance et l’expansion de l’électronucléaire pour atteindre les objectifs mondiaux, que ce soit au moyen de grands réacteurs ou de PRM, exigeront un appui politique et une maîtrise rigoureuse des coûts. « L’élan nécessaire à la réalisation des objectifs est là, mais il faudra davantage de volonté politique », estime Mme des Cloizeaux.